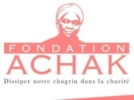(En faire des centralités vivantes et des leviers de développement urbain)
(Gares du BRT et du TER)- Le Sénégal, à travers les projets du Train Express Régional (TER) et du Bus Rapid Transit (BRT), s’est engagé dans une transformation majeure de sa mobilité urbaine, notamment dans l’agglomération dakaroise. Ces infrastructures de transport collectif de masse constituent une avancée décisive vers une mobilité plus durable, plus équitable et plus performante. Toutefois, leur potentiel réel reste aujourd’hui largement sous-exploité.
En effet, les gares du TER et les stations du BRT restent encore de simples points de passage, sans véritable intégration dans leur environnement urbain, sans connexion fluide avec les autres modes de transport et sans impact structurant sur le développement urbain alentour. C’est cette carence stratégique et opérationnelle qu’il convient de corriger en érigeant ces gares en véritables centralités urbaines, selon la vision du grand urbaniste Jaime Lerner (père du BRT). Il s’agit d’en faire les piliers d’une politique ambitieuse de Transport Oriented Development (TOD).
- Les limites actuelles : des équipements de transport coupés de leur contexte
Malgré les investissements colossaux mobilisés pour le TER et le BRT, force est de constater que les gares et stations sont encore pensées avant tout voire exclusivement comme des équipements techniques et non comme des espaces de vie urbaine, des points nodaux et de structuration de l’espace. Leur intégration spatiale, fonctionnelle et sociale reste marginale.
Cela se lit à travers une fragmentation urbaine persistante : nombre de gares sont “isolées” ou mal connectées à leur environnement immédiat. L’accessibilité piétonne, cyclable ou en transport artisanal y est souvent négligée.
Les espaces publics sont absents ou sous-développés : abords des gares insuffisamment aménagés, réduits à des parkings ou à des terrains vagues, au lieu d’être pensés comme des lieux de rencontre, de transition, de connexion, de commerce ou de culture. Des tiers lieux.
Il existe encore de nombreuses opportunités foncières non capitalisées : alors que les terrains autour des gares pourraient accueillir logements, bureaux, commerces, espaces artisanaux, services publics ou tiers-lieux, l’absence de vision d’aménagement globale laisse place à la spéculation ou au vide. Ce que certains techniciens appellent les “délaissés” des voies de communication recèlent, en réalité, de grandes potentialités.
Lire aussi :
À l’origine, la dissociation entre urbanisme et transport (ou plutôt mobilité) fait que les documents d’urbanisme ne sont pas toujours alignés avec les projets de transport et inversement. Les acteurs territoriaux sont rarement impliqués dans une logique d’intégration et de complémentarité. Et c’est ce manque de stratégie intégrée qui compromet l’objectif même du TER et du BRT : structurer un territoire, donner plus d’équilibre, réduire les inégalités d’accès et favoriser un urbanisme plus économe, plus compact, plus résilient et plus efficace.
- Jaime Lerner et la centralité comme moteur de transformation
L’urbaniste brésilien Jaime Lerner, père du BRT et ancien maire de Curitiba (ville pionnière), concevait la gare non pas comme un simple nœud de transport, mais comme un catalyseur d’urbanité, un lieu de convergence entre les différentes fonctions économiques, sociales, culturelles et environnementales de la ville.
Pour lui, chaque arrêt de transport collectif devait être un “acupuncture point” : un point stratégique capable de réactiver la dynamique urbaine environnante. Cette idée prend tout son sens dans une métropole comme Dakar, où l’étalement, les embouteillages, les fractures urbaines et sociales ainsi que la saturation des réseaux exigent des réponses systémiques.
Les gares doivent être des points nodaux, des mini- centralités, des points de couture, etc. C’est pourquoi il est impératif de repenser les gares comme cœurs de TOD et éléments vitaux d’un urbanisme de convergence.
En effet, le TOD (Transport Oriented Development) propose une réponse globale : organiser la ville autour des pôles de transport, avec une densité maîtrisée, une mixité fonctionnelle et sociale et une forte accessibilité multimodale. Mieux encore que la multi ou plurimodalité, c’est l’intermodalité que génère la conjonction féconde entre urbanisme et transports (ou mobilité). Et pour que les gares du TER et les stations du BRT deviennent des centralités efficaces et désirables, voici une série de propositions articulées autour de cette approche.
III. Propositions concrètes et innovantes pour faire des gares des centralités actives
- Concevoir des “Quartiers-Gares” multifonctionnels
Développer autour de chaque gare une ZAC (zone d’aménagement concertée) ou une zone d’intérêt public prioritaire pilotée par une agence d’aménagement. Ces projets devront inclure, dans un rayon d’environ cinq cents (500) à huit cent (800) mètres, des logements (sociaux ou libres), des commerces, des services publics (écoles, dispensaires), des équipements culturels, des espaces verts, des places publiques, etc. Cela suppose d’imposer une densification intelligente et une architecture contextuelle en valorisant notre sociologie urbaine.
- Créer un maillage multimodal fluide
Il importe de relier chaque gare à un réseau de modes doux (pistes cyclables, trottoirs ombragés) et surtout à des lignes de rabattement (minibus, navettes électriques, taxis collectifs). Certes DDD (Dakar Dem Dikk) y travaille mais le projet devrait être plus ambitieux et intégré. Évidemment, il faudrait développer des pôles d’échanges intégrés avec bornes de vélos partagés, consignes, services, etc. et des parkings-relais. Ces derniers devront offrir des tarifs préférentiels aux usagers réguliers. Aussi, fluidifier les échanges passe par une billettique unifiée et des plateformes numériques intégrées (appli unique).
- Activer les abords des gares par des “micro-programmes”
Les abords des gares offrent des opportunités pour installer des kiosques culturels, food trucks, marchés urbains temporaires, centres d’innovation frugale, FabLabs, bibliothèques mobiles, etc.
Cela pourrait passe par le lancement d’appels à projets ouverts pour l’occupation temporaire ou transitoire de friches autour des gares. Plus généralement, s’agit-il aussi d’encourager les initiatives artistiques ou artisanales, inspirées du modèle de “Station F” à Paris (un immense incubateur d’entreprises installé dans un vieux bâtiment ferroviaire) ou “Shibuya Stream” à Tokyo.
- Innover par la gouvernance et le financement
Les projets pourraient être initialisée et menés grâce à une Société d’Aménagement des Gares et Mobilités Urbaines (SAGMU). Ce PPP orlginal regrouperait l’État, les collectivités territoriales, la SENTER, les transporteurs dont Dakar Dem Dikk et les investisseurs privés. On pourrait même adopter des modèles participatifs avec les usagers, riverains, commerçants et jeunes entrepreneurs locaux.
Un autre objectif est de mettre en place des mécanismes de capture de la valeur foncière (land value capture) générée par les infrastructures (exemple : taxation de la plus-value foncière, baux emphytéotiques, transferts de droits à construire, etc.).
- Ancrer chaque gare dans son territoire et son identité
Pour cela, on peut mettre en œuvre des audits sensibles du territoire autour des gares pour révéler les usages, les tensions et les attentes.
À partir de ces connaissances, il est possible de concevoir chaque gare comme une “signature locale”, reflétant l’histoire, les savoirs, les cultures et les aspirations du quartier.
- Exemples inspirants à mobiliser
À Curitiba (Brésil), il y a une articulation réussie entre BRT et développement urbain autour des axes de transport, avec densité, mixité et services à chaque station.
À Hong Kong, il y a le modèle MTR, où le métro finance son expansion via les recettes immobilières autour des gares (Rail + Property Model).
Dans le cadre du Grand Paris Express, le projet de “ville autour des gares” intègre logements, innovation, campus et hubs culturels.
À Séoul, il y a une transformation des stations de métro en pôles culturels et économiques (ex. Dongdaemun Design Plaza – pôle de la mode, du design et destination touristique – connecté directement au métro).
À Abidjan, le projet de centralités autour du métro en construction se nourrit d’une réflexion sur la régulation foncière et l’accessibilité.
La gare comme manifeste d’un urbanisme du futur
Faire des gares du BRT et du TER de véritables centralités, ne devrait pas être un casse-tête insurmontable, c’est une nécessité stratégique pour l’avenir urbain de Dakar. Dans cette métropole en pleine mutation, les gares doivent devenir des laboratoires de la ville inclusive, durable et créative. Loin d’être de simples lieux de transit, elles doivent incarner une vision connectée ou intégrée du développement urbain, de l’économie locale, de la mobilité, de la culture et du vivre-ensemble.
Ainsi, à travers une alliance forte entre planification, innovation, participation, justice spatiale et urbanisme opérationnel ou tactique, le Sénégal a l’occasion de faire école à l’échelle du continent en matière de TOD et de centralités post-coloniales. Les gares du futur ne seront pas seulement des destinations : elles seront des points de coutures et des déclencheurs d’innovation urbaine.
Oumar BA