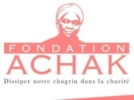(Grande entreprise)- Au cours des six dernières décennies, la littérature économique ainsi que le discours politique consacrés à l’Afrique n’ont cessé de réitérer la promesse d’un « décollage » imminent des économies du continent. Chaque décennie a vu se succéder et se superposer des plans, des stratégies et des slogans novateurs : de l’« industrialisation par substitution aux importations » durant les années 1960 à l’« ajustement structurel » des années 1980, puis à l’« émergence » des années 2000, pour aboutir aujourd’hui à la « transformation structurelle ». Toutefois, en dépit d’une dynamique démographique sans précédent et de ressources naturelles profuses, l’Afrique demeure l’épicentre mondial de la pauvreté en termes absolus. L’une des causes fondamentales de cette stagnation est fréquemment occultée par une forme de déni collectif. Le continent souffre d’une carence structurelle en grandes entreprises, seules entités capables d’intégrer une main-d’œuvre abondante, d’accroître substantiellement la productivité générale et d’agir comme de véritables locomotives de la croissance. Aussi longtemps que le substrat économique demeurera atomisé en une myriade de micro- activités de subsistance, que l’informalité restera la norme et que les firmes ne parviendront pas à une taille critique, toute perspective de « décollage » authentique et durable restera illusoire. Telle est la thèse centrale que je me propose d’étayer dans la présente livraison.
Annuellement, ce sont près de douze millions de jeunes individus qui se présentent sur le marché du travail africain. Face à ce flux démographique considérable, la Banque mondiale estime que seuls trois millions d’emplois relevant du secteur formel sont créés. En conséquence, une écrasante majorité de cette jeunesse se voit contrainte de trouver refuge dans l’économie informelle, par exemple le commerce ambulant, les services domestiques ou les moto- taxis, laquelle, loin de constituer un tremplin vers la prospérité, s’apparente davantage à une zone de relégation économique. Le secteur agricole, qui emploie encore près de 55 % de la population active dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, n’apporte guère de réponse pérenne à ce défi. La productivité y stagne et la taille excessivement réduite des exploitations empêche la génération d’excédents significatifs. À l’encontre d’une perception romantique tenace, l’informalité ne saurait être réduite à une prétendue « culture africaine de l’ingéniosité » recelant des vertus insoupçonnées. Elle constitue en réalité une véritable trappe à pauvreté. Les micro- entités informelles sont exclues des circuits de financement bancaire et des marchés publics ; leur croissance est quasi nulle et les conditions d’emploi qu’elles proposent sont marquées par la précarité, l’absence de protection sociale et un déficit criant de développement des compétences. En somme, si elles permettent de dissimuler statistiquement le chômage, elles n’en résolvent aucunement les causes profondes.
Adam Smith, dans son œuvre fondatrice Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations de 1776, avait déjà magistralement démontré que la prospérité d’une nation est intrinsèquement liée à la productivité, laquelle découle de la spécialisation permise par la division du travail et de l’extension des marchés. Une manufacture employant cinq cents ouvriers au sein d’une chaîne de production optimisée génère une valeur ajoutée sans commune mesure avec celle produite par plusieurs centaines d’artisans œuvrant de manière isolée. Or, l’Afrique se caractérise justement par l’absence de ces « firmes organisatrices » qui transmutent la force de travail brute en une véritable puissance productive. L’Afrique subsaharienne compte ainsi moins d’un millier d’entreprises de taille intermédiaire ou de grande envergure capables d’exporter de façon significative. En guise de comparaison saisissante, l’Italie, avec une population de soixante millions d’âmes, en dénombre plus de vingt mille. Cette disparité n’est pas anecdotique, elle est au cœur du problème.
Lire aussi :
L’impact d’une grande entreprise transcende largement le périmètre de ses salariés directs. Elle engendre une multitude d’emplois indirects chez ses fournisseurs, ses sous-traitants et dans les services connexes. Elle agit comme un vecteur de diffusion de normes de qualité et de standards de productivité dans l’ensemble de l’économie. De surcroît, sa contribution fiscale substantielle habilite l’État à financer les infrastructures et les services publics essentiels. Ainsi, chaque emploi formel créé par une grande firme est susceptible d’en générer deux à trois supplémentaires dans son écosystème. La perspective historique corrobore cette analyse. Dans l’Angleterre du XIXe siècle, la révolution industrielle fut l’œuvre non pas d’artisans indépendants, mais de manufactures, de compagnies minières et d’entreprises textiles à même de mobiliser capital et travail à très grande échelle. Au Japon, dès l’ère Meiji dans les années 1870, l’État a délibérément favorisé l’ascension des zaibatsu (tels que Mitsui ou Mitsubishi), qui devinrent les fers de lance de l’industrialisation. De même, les célèbres chaebols (Samsung, Hyundai) en Corée du Sud ou les conglomérats taïwanais ont été les moteurs de l’exportation et ont permis la constitution d’une classe moyenne robuste. Dans chacun de ces cas de développement spectaculaire, le basculement vers la prospérité ne fut pas le fait des micro-entreprises, mais bien celui de grandes entités corporatives solidement intégrées aux chaînes de valeur mondiales.
Depuis une décennie, les bailleurs de fonds et les gouvernements africains eux-mêmes célèbrent avec emphase l’« entrepreneuriat des jeunes », multipliant à l’envi concours, hackathons et programmes de micro-crédit. Cependant, dans plus de 90 % des cas, ces initiatives aboutissent majoritairement à la création d’activités de subsistance éphémères, dénuées de tout impact macroéconomique significatif. À titre illustratif, au Nigeria, plus de 40 % des jeunes diplômés se lancent dans de modestes unités de commerce en ligne ou de services, dont la pérennité est compromise par un manque d’échelle critique. Certains observateurs, cédant à une vision quelque peu romantique, perçoivent dans l’informel une vitalité créatrice. Le contraste avec les trajectoires de l’Asie de l’Est s’avère pourtant saisissant et instructif : dans cette région, les pouvoirs publics ont mis en œuvre des stratégies volontaristes visant à formaliser, à structurer et à catalyser la croissance de leurs entreprises. D’autres encore préconisent un illusoire « retour à la terre ». Mais il convient de rappeler que l’Afrique importe annuellement pour plus de soixante milliards de dollars de produits alimentaires. En l’absence d’entreprises d’envergure capables d’orchestrer la logistique, la transformation agroalimentaire et la distribution à grande échelle, le secteur agricole demeurera confiné à une logique de subsistance plutôt que de se muer en un puissant moteur de création de richesse.
Ma conviction est que l’Afrique est victime d’un préjugé idéologique persistant qui érige la « petite taille » en vertu cardinale, au détriment de l’efficacité. Pourtant, comme le rappelait l’économiste Joseph Schumpeter, c’est au sein de la grande entreprise que réside le principal foyer de l’innovation et de l’efficience économique. Il est impératif de rompre avec ce paradigme. Par ailleurs, le rôle des gouvernements africains est, ici, crucial. Il ne s’agit nullement pour l’État de se substituer au marché en créant ex nihilo des champions nationaux, mais bien de démanteler les entraves qui inhibent la croissance des entreprises existantes, qu’il s’agisse d’une fiscalité confiscatoire, de la corruption endémique ou d’une réglementation arbitraire.
L’Afrique se trouve à une croisée des chemins historique. Elle peut soit persister dans la glorification de l’auto-entrepreneuriat de survie, en multipliant les slogans incantatoires et en entretenant l’illusion d’un développement perpétuellement ajourné, soit affronter une vérité incontournable. Sans un tissu dense de grandes entreprises, aucune transformation structurelle véritable ne pourra advenir. L’urgence commande donc l’adoption d’une doctrine économique lucide et pragmatique : toute politique publique, tout programme d’aide au développement devrait être rigoureusement évalué à l’aune de sa capacité à favoriser l’expansion et la montée en gamme des entreprises locales. Il en va du réalisme historique, de l’efficience économique et, en définitive, de la justice sociale. Car seule une économie structurée par des firmes prospères, capables d’employer massivement, d’investir, d’exporter et de s’acquitter de leurs obligations fiscales, sera en mesure d’offrir à la jeunesse africaine un horizon à la hauteur de ses légitimes aspirations.
À ceux qui nourrissent le rêve d’un « autre modèle africain » qui serait fondé sur l’informalité et l’ingéniosité individuelle, je réponds par les mots de l’économiste Ludwig von Mises : « Ce n’est pas la pauvreté qui a besoin d’être expliquée, mais la richesse. Et la richesse est toujours le fruit de l’organisation et de la coopération dans le cadre du marché. »
Jed Sophonie KOBOUDE

Dirigeant d’un think tank parisien centré sur les questions africaines et il enseigne l’économie dans le cadre du parcours MBA du Centre de Valorisation Professionnelle de Tunis. Essayiste, il a déjà publié quatre ouvrages. Membre du Conseil d’administration d’InterGlobe Conseils, il supervise également le département des économies africaines et internationales.