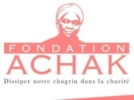(Racines sociales du blocage économique)- Dans son analyse pénétrante de la démocratie, Alexis de Tocqueville soulignait que les institutions démocratiques ne s’épanouissent qu’à la condition d’un état social propice, où l’égalité des conditions et l’esprit civique forment le terreau fertile d’un gouvernement participatif. Cette vérité, forgée par l’histoire mondiale, trouve en Afrique un écho singulier. L’imposition hâtive de la démocratie institutionnelle sur des sociétés marquées par des hiérarchies rigides, des loyautés claniques et des fractures ethniques n’a-t-elle pas engendré des dysfonctionnements profonds ? Et, cet état social non démocratique n’explique- t-il pas les entraves persistantes au décollage économique du continent ? Dans cette livraison, je vais tenter de démontrer que la démocratie ne prospère qu’après la consolidation d’un état social démocratique, que les structures sociales africaines restent largement en déphasage avec cet idéal, et que ces réalités éclairent les défis tant politiques qu’économiques auxquels l’Afrique fait face.
L’état social démocratique comme précurseur de la démocratie institutionnelle.
L’histoire mondiale offre une leçon claire : la démocratie institutionnelle ne prospère durablement que lorsqu’elle repose sur un état social démocratique. Déjà au 19ème siècle, Tocqueville insistait sur l’égalisation des conditions : pour qu’un régime démocratique subsiste, il faut que « les différences de fortune et de position ne forment pas des fossés infranchissables » (Tocqueville). L’examen empirique confirme cette intuition. Une étude globale récente montre qu’au 19ème et 20ème siècles, les régimes démocratiques durables apparaissent d’abord dans les sociétés relativement égalitaires. Par exemple, les cantons suisses des Alpes et les États du Nord-Est des États-Unis, où les écarts de revenus étaient faibles, ont instauré tôt des droits politiques étendus. Inversement, les grandes sociétés rurales et inégalitaires (les États du Sud des États-Unis avant la Guerre de Sécession, les empires coloniaux inégalitaires) ont maintenu longtemps un système oligarchique ou esclavagiste. Dans l’histoire européenne, les grands tournants démocratiques ont coïncidé avec l’abolition des privilèges et des hiérarchies traditionnelles. La Révolution française de 1789, par son vote des « décrets d’abolition des privilèges », supprima les anciens droits féodaux et corporatifs, nivelant juridiquement la noblesse et le clergé avec le Tiers état. Cette rupture sociale fut un terreau favorable à la République (ce que Guizot appelait l’« état social démocratique »). Aux États-Unis, l’égalité relative des colons puritains et les réformes frontalières (développement des écoles publiques, émancipation des serviteurs sous contrat, suppression graduelle des conditions censitaires dans le Nord) permirent d’étendre massivement le suffrage bien avant la Guerre de Sécession. Au contraire, la démocratie y fut systématiquement entravée dans les régions marquées par l’esclavage et les grands propriétaires esclavagistes. De façon générale,les gros propriétaires fonciers ont statistiquement résisté à la démocratie. De même en Asie, les démocraties apparaissent après des réformes égalitaristes profondes. Le cas du Japon est éclairant : la démocratie parlementaire n’a pris son essor qu’après la Seconde Guerre mondiale, quand l’occupant américain fit le nettoyage des vestiges féodaux. La nouvelle Constitution japonaise de 1947 fut imposée aux élites ; en parallèle, les réformes sociales détruisirent les derniers monopoles, grands groupes familiaux, mécanismes fonciers féodaux et la noblesse. L’occupation MacArthur institua une vaste réforme agraire et brisa les zaibatsu (grands conglomérats). Ces mesures égalisèrent le paysage social (multiplication de petits paysans propriétaires, instruction de masse, décentralisation de la propriété), préparant un terrain démocratique. Sans ces réformes, la culture politique résiduelle au Japon (empreinte de corporatisme et de loyauté clientéliste) aurait probablement étouffé toute démocratie parlementaire.
Lire aussi :
L’état social non démocratique en Afrique.
À l’inverse des exemples ci-dessus, nombre de sociétés africaines contemporaines sont caractérisées par des structures sociales traditionnelles et hiérarchiques : systèmes de castes ou de métiers héréditaires en Afrique de l’Ouest, où les nobles horon se distinguent encore des nyamakala (forgerons, griots, tisserands), et interdits d’alliance matrimoniale maintiennent la stratification ; chefferies lignagères et autorités coutumières, reconnues pour leur légitimité sacrée, cohabitent et s’imbriquent avec les institutions modernes. À ces clivages s’ajoutent le clientélisme électoral fondé sur les appartenances ethniques ou régionales, la primauté du lien de parenté sur l’adhésion idéologique, et une forte révérence envers l’autorité des aînés. Ensemble, ces logiques de caste, de clan et de patronage perpétuent une société segmentée, plus fidèle aux obligations traditionnelles qu’aux principes égalitaires de la démocratie.
Pourquoi ces structures bloquent la démocratie et le développement.
Ces structures sociales non démocratiques en Afrique ont deux conséquences étroitement liées : elles fragilisent les institutions politiques et elles parasitent le développement économique. D’un point de vue politique, la persistance de castes et de clans engendre en pratique une démocratie biaisée. Les élections sont faussées par le clientélisme : on vote non pas pour une vision de société globale, mais pour la promesse d’une faveur individuelle (emploi, subvention, prestation) distribuée dans son groupe ethnique. Des études comparatives le confirment : là où domine la logique tribale, les ressources publiques sont réaffectées à des réseaux clientélistes, et non à un développement partagé. Dans plusieurs pays africains, la confiance des citoyens est ainsi souvent placée dans leur ethnie plutôt que dans la nation, et on relève une méfiance exacerbée envers les institutions centrales. Autrement dit, l’État de droit s’effondre partiellement : le service public est détourné au profit d’intérêts privés (votes de survie pour les barons locaux), la justice est perçue comme inéquitable (on juge selon l’identité du justiciable), et les élites légifèrent pour protéger leurs alliances internes. Tout cela rend les institutions peu fiables : selon un rapport du FMI sur la fragilité des institutions en Afrique, les populations de pays en conflit s’identifient souvent plus à leur groupe ethnique qu’à la nation. Le phénomène des partis « ethniques » reflète cette logique : en l’absence de conscience nationale unifiée, les partis mobilisent avant tout l’ethnie du leader pour gagner des voix, affaiblissant le pluralisme véritable.
Ces mêmes structures sociales pèsent lourdement sur l’économie et la société civile. Le népotisme et le tribalisme ont pour effet d’exclure du système les individus « hors clan » et de brider la mobilité sociale. Une étude récente note que le tribalisme népotique en Afrique entraîne la sélection de personnes incompétentes par affinité ethnique, créant de l’inefficacité endémique. Par exemple, il n’est pas rare de constater dans une entreprise publique en Afrique que la plupart des cadres supérieurs sont choisis parmi les membres d’un même clan – au mépris des compétences – ce qui paralyse l’entreprise. Les services publics se détériorent, la corruption fleurit et les projets de développement échouent, car les postes clés sont alloués selon la loyauté tribale plutôt que le mérite. À l’échelle macroéconomique, cette capture du pouvoir par des réseaux privilégiés conduit à des investissements déséquilibrés : on lance des projets publics basés sur des intérêts locaux (routes reliant le fief d’un clan, par exemple) plutôt que sur des besoins stratégiques. En conséquence, l’allocation inefficace des ressources freine la croissance et aggrave la pauvreté et les inégalités. Le favoritisme tribal restreint l’accès aux opportunités : les talents individuels sont gaspillés lorsqu’ils n’appartiennent pas au groupe dominant, ce qui accroît l’exclusion sociale.
Au total, la prégnance de ces hiérarchies tribales explique en grande partie la faiblesse et la fragilité des démocraties africaines. Les institutions formelles (État de droit, régulations électorales, équilibre des pouvoirs) sont constamment contournées par les réseaux sociaux de clientélisme. On observe, dans la pratique, des scrutins biaisés (achat de voix, falsification tolérée au profit du parti au pouvoir dans certaines régions), un pluralisme de façade (partis ethniques sans véritable programme national), et un système judiciaire peu indépendant (les clans protègent leurs cadres). Cela explique pourquoi beaucoup d’États africains stagnent politiquement et économiquement.
Jed Sophonie KOBOUDE

Dirigeant d’un think tank parisien centré sur les questions africaines et il enseigne l’économie dans le cadre du parcours MBA du Centre de Valorisation Professionnelle de Tunis. Essayiste, il a déjà publié quatre ouvrages. Membre du Conseil d’administration d’InterGlobe Conseils, il supervise également le département des économies africaines et internationales.