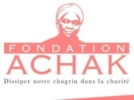(Prospérité béninoise)- Au Bénin, la flamboyance des indicateurs macro-économiques (plus de 5 % de croissance annuelle depuis 2016) dissimule un tiraillement silencieux : celui qui oppose les « anywhere », classes urbaines mobiles arrimées aux flux mondiaux et numériques, aux « somewhere », populations rurales ou péri-urbaines, attachées à la terre, pauvres et confinées dans l’informel. Cette distinction, empruntée à David Goodhart, permet de mieux saisir les dynamiques à l’œuvre dans l’économie béninoise contemporaine. Derrière l’unanimisme des bilans officiels s’inscrit donc une discordance sociale qu’aucune liturgie budgétaire ne saurait effacer. Traiter ce mal requiert, à la manière d’un médecin, de suivre l’ordre rigoureux de la clinique : l’observation statistique, le diagnostic causal, le pronostic conditionnel et, enfin, la thérapeutique politique. C’est ce à quoi je vais m’atteler dans cette livraison.
La statistique, l’anamnèse des faits
Le Bénin affiche depuis 2016 une croissance économique dynamique, supérieure à la moyenne africaine. Mais, la croissance économique du Bénin n’est pas inclusive. Ce n’est pas une opinion, c’est un fait. L’indice de Gini, qui est une mesure de la répartition des richesses, a augmenté, au Bénin, de 0,4 à 0,43 entre 2016 et 2022, selon la Banque mondiale. Cela signifie que la richesse est devenue plus concentrée. En 2022, les 10% les plus riches de la population détiennent plus de 40% des revenus nationaux, tandis que les 50% les plus pauvres en cumulent moins de 20%. Les inégalités sont particulièrement prononcées entre les zones rurales et urbaines : les revenus des ménages ruraux sont en moyenne trois fois inférieurs à ceux des ménages urbains. De plus, 36 % de la population demeure sous le seuil national de pauvreté et plus de neuf travailleurs sur dix évoluent hors du salariat formel. L’inégalité géographique est patente : dans l’Atacora, plus d’un habitant sur deux est pauvre, quand le Littoral – Cotonou en tête – n’en compte qu’un sur cinq. Tandis que le secteur tertiaire urbain concentre plus de la moitié de la valeur ajoutée, l’agriculture ne dépasse pas un quart du PIB et végète faute d’infrastructures secondaires adaptées.
Lire aussi :
Le diagnostic, l’étiologie des faits
Le diagnostic de la situation (Anywhere VS Somewhere) met en lumière plusieurs facteurs explicatifs. L’accès très inégal au capital humain et financier demeure la première cause de ce fossé grandissant. Les élites urbaines disposent d’une éducation de qualité supérieure, bénéficient davantage d’opportunités économiques, et profitent aisément des mécanismes de crédit et d’investissement. À l’inverse, les ruraux, enfermés dans des systèmes productifs peu rémunérateurs, subissent des infrastructures déficientes et un accès limité aux services essentiels. Ce diagnostic s’aggrave par la faiblesse persistante des institutions béninoises, marquées par le clientélisme et la corruption, qui favorisent la rente plutôt que la performance. Enfin, la structure économique trop dépendante du coton et des échanges frontaliers informels avec le Nigeria accentue les rentes dont les Anywheres bénéficient de façon disproportionnée. Le résultat est une croissance sans diffusion : les gains de productivité du secteur moderne (industrie légère, BTP) ne ruissellent pas vers l’arrière-pays, faute d’infrastructures secondaires, de droits de propriété sécurisés et de marchés financiers inclusifs. L’informel absorbe l’essentiel de la main-d’œuvre, écrasant l’accumulation de capital humain et maintenant un phénomène de sous-emploi.
Le pronostic, l’évolution probable
Si rien ne change, la décennie qui s’ouvre verra la dualisation se durcir : migrations internes accrues vers le sud, prix fonciers en spirale et, corrélativement, ressentiment identitaire dans les départements moins dotés. À moyen terme, le Bénin pourrait buter sur un piège à revenu intermédiaire : le tertiaire logistique saturerait, tandis que les rentes portuaires s’éroderaient face à la concurrence togolaise et ghanéenne. Ce scénario risquerait à terme d’affaiblir la cohésion sociale et d’alimenter des frustrations, voire des tensions entre les Somewheres laissés-pour-compte et les Anywheres toujours plus privilégiés. Inversement, un scénario vertueux reste envisageable : celui d’une transition inclusive où l’agro-industrie, l’énergie abondante et pas chère et l’économie numérique relaient la locomotive portuaire. Mais cette issue repose sur une métamorphose institutionnelle rapide, sans quoi l’écart entre anywhere et somewhere se figera ou s’agrandira.
La thérapeutique, l’ordonnance
La première prescription tient à la sécurisation foncière. Tant qu’un agriculteur ne pourra gager sa parcelle en détenant les titres de propriété, l’épargne populaire demeurera stérile. Un cadastre numérique, doublé de titres universels négociables, transformerait la terre en collatéral et donc en capital. Seconde mesure : instaurer des zones d’opportunité fiscales dans les départements pauvres afin d’y attirer l’agribusiness et la production d’électricité solaire hors réseau, seule capable de court-circuiter le déficit d’infrastructures. Troisièmement, ouvrir un véritable marché financier domestique, où le micro-capital-investissement, libéré des carcans prudentiels anachroniques des banques, irriguerait start-up rurales et ateliers. Enfin, la confiance institutionnelle doit être regénérée.
Convertir la croissance « anywhere » en prospérité « everywhere » suppose de briser le verrou de la question des droits de propriété et de libérer la concurrence. À défaut, le Bénin continuera d’avancer au pas d’un funambule : les yeux rivés sur des indicateurs macroéconomiques trompeurs, mais les pieds posés sur un fil social de plus en plus ténu.
Jed Sophonie KOBOUDE

Dirigeant d’un think tank parisien centré sur les questions africaines et il enseigne l’économie dans le cadre du parcours MBA du Centre de Valorisation Professionnelle de Tunis. Essayiste, il a déjà publié quatre ouvrages. Membre du Conseil d’administration d’InterGlobe Conseils, il supervise également le département des économies africaines et internationales.