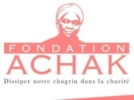(Financement des PME) – Dans les marchés émergents, le financement des petites et moyennes entreprises (PME) demeure l’un des principaux leviers de développement économique et social. Ces entreprises représentent environ 90 % du tissu entrepreneurial mondial et plus de 50 % des emplois à l’échelle de la planète (World Bank, 2023). Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, leur rôle est encore plus déterminant, les PME générant jusqu’à 70 % des emplois formels et contribuant à hauteur de 40 % du produit intérieur brut (PIB). Malgré cette importance systémique, un déficit de financement structurel persiste : le manque de crédit accessible aux PME est estimé à près de 5,7 billions USD. Entre 2015 et 2019, le déficit de financement des PME a augmenté de plus de 6 % par an, alors même que l’offre de crédit progressait de 7 %. (IFC, 2025).
Derrière ces chiffres se cache un paradoxe qui illustre les tensions du système financier. Alors que la révolution numérique transforme la finance et multiplie les canaux d’accès au crédit, de nombreuses PME demeurent exclues des circuits formels. Cette exclusion découle d’un ensemble de facteurs : insuffisance de données financières fiables, absence de garanties tangibles, et, souvent, une méfiance vis-à-vis des institutions financières et des outils technologiques. Le défi ne réside donc plus seulement dans l’innovation technologique, mais dans la capacité à combiner le numérique et l’humain. Il devient impératif d’allier la précision des outils digitaux — dont les mécanismes d’analyse et de décision intègrent désormais de plus en plus des composantes d’intelligence artificielle — avec la compréhension contextuelle qu’apporte la relation sur le terrain.
Les chargés d’affaires : un trait d’union
Le rôle du chargé d’affaires illustre parfaitement cette dualité. L’accès au crédit ne dépend pas uniquement de la disponibilité des ressources, mais également de la nature de l’information mobilisée pour évaluer le risque. Dans les économies émergentes, les PME évoluent fréquemment dans des environnements à forte informalité où les états financiers officiels ne reflètent qu’une partie de l’histoire. C’est ici qu’intervient la dimension qualitative de la connaissance du client. Le chargé d’affaires, par sa proximité et son observation continue, collecte des éléments qu’aucun algorithme ne peut entièrement capturer : le savoir-faire de l’entrepreneur, la fiabilité d’un fournisseur clé, la stabilité d’une équipe familiale, la réputation locale d’un atelier, le potentiel commercial d’un nouveau point de vente, etc. Ces informations constituent des données qualitatives qui, une fois documentées et analysées, deviennent une ressource précieuse pour la gestion du risque de crédit. Les solutions numériques ne peuvent pas non plus bâtir la relation de confiance, spécialement pour cette clientèle qui peut craindre les institutions financières et les autorités fiscales. Le chargé d’affaires doit désamorcer ces inquiétudes pour pouvoir accéder aux informations du client, en toute transparence.
Les outils numériques comme multiplicateurs de compétences
L’opposition entre technologie et expertise humaine constitue un faux dilemme. Dans le financement des PME, la technologie n’a pas vocation à remplacer le chargé d’affaires, mais à renforcer son efficacité. Les systèmes numériques, en particulier les logiciels de gestion de la relation client (CRM, Customer Relationship Management), de gestion de l’octroi de crédit (LOS, Loan Origination System) et de gestion du portefeuille de prêts (LMS, Loan Management System) agissent comme des multiplicateurs de compétences.
Lire aussi :
Un CRM bien conçu centralise et structure l’ensemble des interactions entre l’institution financière et ses clients : communications, visites, demandes de crédit, incidents de paiement ou opportunités commerciales. Il offre une vision intégrée et dynamique du pipeline et du portefeuille, garantissant la cohérence et la continuité de la relation, même en cas de changement d’interlocuteur. Selon Salesforce et WebFX (2023), l’utilisation systématique d’un CRM se traduit par une augmentation moyenne de 21 % de la productivité commerciale et de 16 % du taux de fidélisation de la clientèle. Le CRM devient ainsi la mémoire institutionnelle de la relation, une infrastructure de connaissance partagée qui transforme l’expérience client en avantage compétitif durable.
Connecté à ce dispositif, le LOS rationalise l’ensemble du processus d’octroi. La collecte des données est dématérialisée, les justificatifs sont intégrés, et les ratios financiers, dont la capacité d’endettement, sont calculés instantanément à partir des informations saisies, présentes et conservés au système. Cette interconnexion assure une circulation fluide entre le chargé d’affaires, le middle office et le comité de crédit, réduisant considérablement les délais de traitement. Dans certaines institutions financières, les procédures qui nécessitaient plusieurs semaines sont désormais achevées en quelques jours.
Une fois le financement octroyé, le LMS prend le relais pour assurer le suivi et la supervision du portefeuille tout au long du cycle de vie du prêt. L’automatisation des tâches permet de réduire les coûts de gestion et d’améliorer la qualité de suivi. D’après une étude de McKinsey (2022), la mise en œuvre d’un LMS dans des environnements de prêts à volume élevé permet de réduire les coûts opérationnels de 25 à 30 %, tout en améliorant la traçabilité et la conformité réglementaire. Ces outils numériques sont souvent intégrés avec ce qu’on appelle un CBS (Core Banking System) qui peut comprendre plusieurs interfaces jusqu’aux plateformes client.
L’expérience d’IndusInd Bank en Inde illustre de manière empirique les bénéfices de cette intégration technologique. En intégrant un CRM à ses systèmes LOS et LMS existants, la banque a réduit ses délais de traitement de 60 %, augmenté de 50 % son taux de conversion commerciale et amélioré de 90 % la rapidité de son service. Ces gains d’efficacité se sont traduits par un renforcement de la relation client : les chargés d’affaires ont pu consacrer davantage de temps aux visites sur le terrain, à la compréhension des besoins spécifiques et à la proposition de solutions adaptées (IndusInd Bank, 2021).
La connaissance du client, la confiance et la proximité comme fondations de la relation
La qualité d’une relation PME-banque repose avant tout sur la continuité et la confiance. Lorsqu’un chargé d’affaires accompagne le même portefeuille durant plusieurs années, il acquiert une compréhension fine des cycles d’activité : saisonnalité des ventes, dépendance à certains clients, pressions concurrentielles ou changements d’approvisionnement. Cette stabilité renforce la confiance de l’entrepreneur et accroît la capacité de la banque à anticiper les risques plutôt qu’à les subir. À l’inverse, un roulement trop fréquent du personnel affaiblit cette relation et génère des coûts d’apprentissage répétés.
La proximité, qu’elle soit géographique ou relationnelle, joue un rôle complémentaire. Les visites d’entreprises, les entretiens informels et les échanges fréquents permettent de détecter des informations que les données comptables ne révèlent pas : un nouveau contrat, une opportunité d’exportation ou une tension de trésorerie imminente.
Un CRM bien structuré soutient cette logique de proximité et de continuité. En centralisant les historiques de contacts, les notes de visite, les rappels et les opportunités identifiées, il permet un suivi régulier et cohérent de chaque client. Plus encore, il protège la mémoire institutionnelle : lorsqu’un chargé d’affaires quitte son poste ou qu’une rotation de personnel intervient, l’information enregistrée garantit la continuité du service. C’est l’institution financière, et non plus l’individu, qui détient la connaissance du client. Toutefois, cet avantage n’existe que si les données sont saisies de manière rigoureuse et si les employés comprennent la valeur stratégique de l’outil. Un CRM bien alimenté ne se substitue pas à la relation humaine, mais il en préserve la trace et en assure la durabilité, transformant la proximité individuelle en capital relationnel collectif.
Un modèle hybride pour une finance inclusive
Dans le financement des PME, la complémentarité entre technologie et expertise humaine constitue la clé d’un modèle durable et inclusif. Le numérique apporte la rapidité, la rigueur et la portée analytique ; l’humain apporte la compréhension, la confiance et la capacité d’interprétation. Le CRM, le LOS et le LMS ne remplacent pas le jugement du chargé d’affaires, mais lui permettent de se concentrer sur sa véritable valeur ajoutée : l’accompagnement stratégique des entrepreneurs et la création de relations de long terme.
Dans les économies émergentes, où la relation précède inévitablement la transaction, cet équilibre entre intelligence artificielle et intelligence humaine représente une condition essentielle pour étendre l’accès au financement, tout en préservant la qualité et la stabilité des portefeuilles. La technologie devient ainsi le prolongement de la relation, non son substitut.
La formation et la montée en compétence des collaborateurs sur ces sujets constituent désormais un enjeu essentiel pour les établissements financiers, leur permettant à la fois de satisfaire les attentes de leurs clients PME et de maintenir un portefeuille de crédits sain, rentable et équilibré.
François RANCOURT
Expert en financement des MPME et co-auteur de la formation en ligne de la Frankfurt School « Certificat d’Expert en Financement des PME »