(Economie béninoise)- Dans cette livraison, je vais évoquer un sujet d’une importance capitale pour le Bénin. Il s’agit d’un phénomène économique qui, tel un voleur silencieux, dérobe peu à peu la prospérité et l’indépendance du Bénin : le déficit chronique de notre balance des paiements courants.
Que le lecteur veuille bien considérer le graphique ci-après :

Source : BCEAO
Les faits sont clairs. Depuis des décennies, le Bénin accumule un déficit chronique de la balance des paiements courants. Petite parenthèse. Vous vous demandez peut-être : « Qu’est-ce donc que cette balance des paiements courants, et en quoi son déficit nous concerne-t-il ? » Laissez-moi vous l’expliquer à travers une métaphore simple, mais éclairante. Imaginez l’économie béninoise comme un grand ménage. Chaque mois, ce ménage a des revenus (ce qu’il vend à l’étranger) et des dépenses (ce qu’il achète à l’étranger). La balance des paiements courants, c’est simplement la différence entre ces revenus et ces dépenses. Lorsque nous dépensons plus que nous ne gagnons, nous sommes en déficit. C’est précisément la situation dans laquelle se trouve le Bénin depuis de trop nombreuses années. Nous sommes comme une famille qui, mois après mois, année après année, dépense plus qu’elle ne gagne. Trêve de métaphores et revenons à de l’analyse économique.
L’équation comptable (S – I) + (T – G) = X – M sert de point de départ. Cette identité macroéconomique établit un lien direct entre les comportements d’épargne et d’investissement d’une nation (S – I), ses finances publiques (T – G, impôts moins dépenses publiques), et sa balance des paiements courants (X – M, exportations moins importations). Lorsque la balance des paiements courants est en déficit, c’est-à-dire lorsque (X – M) est négatif, cela implique que le pays importe plus qu’il n’exporte. Ce déficit peut provenir de deux sources principales : une insuffisance d’épargne nationale (S – I négatif) ou un excès de dépenses publiques (T – G négatif).
Dans le cas du Bénin, le déficit de la balance courante découle en partie de ces deux facteurs, ce qui montre une économie structurellement déséquilibrée. La faiblesse de l’épargne nationale par rapport aux besoins d’investissement internes conduit à un recours massif à des financements extérieurs, et l’excès de dépenses publiques exacerbe la situation, alourdissant encore davantage la dépendance vis-à-vis des créanciers étrangers.
Lire aussi:
Pour mieux cerner les implications économiques de ce phénomène, il est crucial de se pencher sur les tendances historiques des comptes extérieurs du Bénin. Depuis les années 2000, le pays enregistre systématiquement un déficit de sa balance courante, qui oscille entre 6 % et 9 % du PIB en fonction des années. En 2019, par exemple, le déficit courant s’établissait à environ 7 % du PIB, avant de se creuser encore plus sous l’effet de la crise économique mondiale liée à la pandémie de COVID-19. Les exportations du Bénin, dominées par des produits de base tels que le coton et le pétrole, ne suffisent pas à équilibrer le montant des importations, principalement en produits manufacturés et en énergie. Ce déséquilibre structurel reflète une incapacité à diversifier la base économique et à générer des excédents commerciaux dans d’autres secteurs.
L’économiste Jean-Marc Daniel, dans ses écrits sur la gestion des déficits courants, met en garde contre cette situation de dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs, qu’il considère comme un indicateur de vulnérabilité économique. Selon lui, un pays qui accumule des déficits courants doit nécessairement les financer par des flux de capitaux entrants, souvent sous forme de dette extérieure ou d’investissements directs étrangers (IDE). Ce type de financement est doublement risqué : il peut être coûteux (dans le cas de la dette) et entraîne une perte de contrôle sur les actifs nationaux (dans le cas des IDE).
Jacques Rueff, économiste français du XXe siècle et grand théoricien des politiques monétaires, a longuement souligné l’importance de l’épargne nationale pour maintenir un équilibre économique soutenable. Selon lui, une nation qui souffre d’un déficit chronique de la balance des paiements courants révèle avant tout un déficit d’épargne interne. Le Bénin, avec son faible taux d’épargne, incarne parfaitement ce schéma. L’épargne nationale, qu’elle soit privée ou publique, est cruciale pour financer l’investissement intérieur sans recourir à des capitaux étrangers. Or, au Bénin, la faible capacité des ménages à épargner, en raison de bas revenus et d’un pouvoir d’achat limité, freine la constitution de ce réservoir de fonds domestiques. Ainsi, l’investissement nécessaire pour moderniser les infrastructures et dynamiser la production repose de plus en plus sur de l’épargne du reste du monde. Ce recours à des financements extérieurs pour combler l’écart entre l’épargne et l’investissement entraîne à long terme une montée de la dette extérieure et une détérioration de la position extérieure nette du pays.
Que le lecteur veuille (à nouveau) considérer le graphique suivant :

Source : BCEAO
Le déficit de la balance des paiements courants entraîne une autre conséquence économique grave : la détérioration continue de la position extérieure nette. Cet indicateur mesure la différence entre les avoirs qu’un pays détient à l’étranger et ses engagements envers les créanciers extérieurs. En d’autres termes, il s’agit de savoir si un pays est créditeur ou débiteur net vis-à-vis du reste du monde. Dans le cas du Bénin, la position extérieure nette s’est détériorée au fil des ans, signe que le pays est de plus en plus possédé par des entités étrangères. Entre 2010 et 2020, la position extérieure nette du Bénin est passée de -25 % à environ -40 % du PIB, ce qui signifie que la dette extérieure et les autres engagements financiers vis-à-vis de l’étranger ont fortement augmenté. Cette détérioration reflète non seulement le recours croissant à des emprunts extérieurs pour financer le déficit courant, mais aussi une plus grande prise de participation étrangère dans des secteurs de l’économie.
Le rôle de l’État dans la gestion du déficit courant ne peut être ignoré. Si l’épargne privée est insuffisante, il incombe à l’État de veiller à un équilibre budgétaire rigoureux. Malheureusement, au Bénin, comme dans nombre de pays en développement, la politique budgétaire tend à être expansionniste, avec des dépenses publiques qui excèdent largement les recettes fiscales. Cette tendance est exacerbée par la nécessité de financer des projets d’infrastructures souvent essentiels mais coûteux, qui sont indispensables pour le développement à long terme mais qui creusent à court terme le déficit de la balance courante.
Lorsque l’État engage des dépenses non productives ou mal calibrées, cela peut exacerber les déséquilibres. Par exemple, des investissements massifs dans des projets mal conçus ou dans des infrastructures inadaptées peuvent entraîner un gaspillage de ressources et un retour sur investissement insuffisant, aggravant ainsi le besoin de financement extérieur. Ce cercle vicieux, où des dépenses publiques inefficaces engendrent un besoin accru d’endettement extérieur, devient difficile à briser.
Le redressement de notre balance des paiements courants n’est pas qu’une affaire de chiffres et de statistiques. C’est un impératif moral. C’est la condition sine qua non de notre indépendance économique, de notre souveraineté politique et de notre dignité nationale.
Par Jed Sophonie KOBOUDE

Ingénieur diplômé de l’école CentraleSupélec à Paris et économiste diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris. Il a accompagné plusieurs startups dans la structuration de leur business en Afrique. Business Analyst chez un leader mondial de l’énergie, il est passionné par les nouvelles technologies de l’information, l’économie, l’énergie, et l’Afrique.












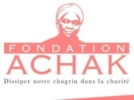



[…] keynésien)- Dans le paysage économique du Bénin, comme dans de nombreux pays en développement, une croyance persiste avec une ténacité remarquable : celle du multiplicateur keynésien. Cette […]